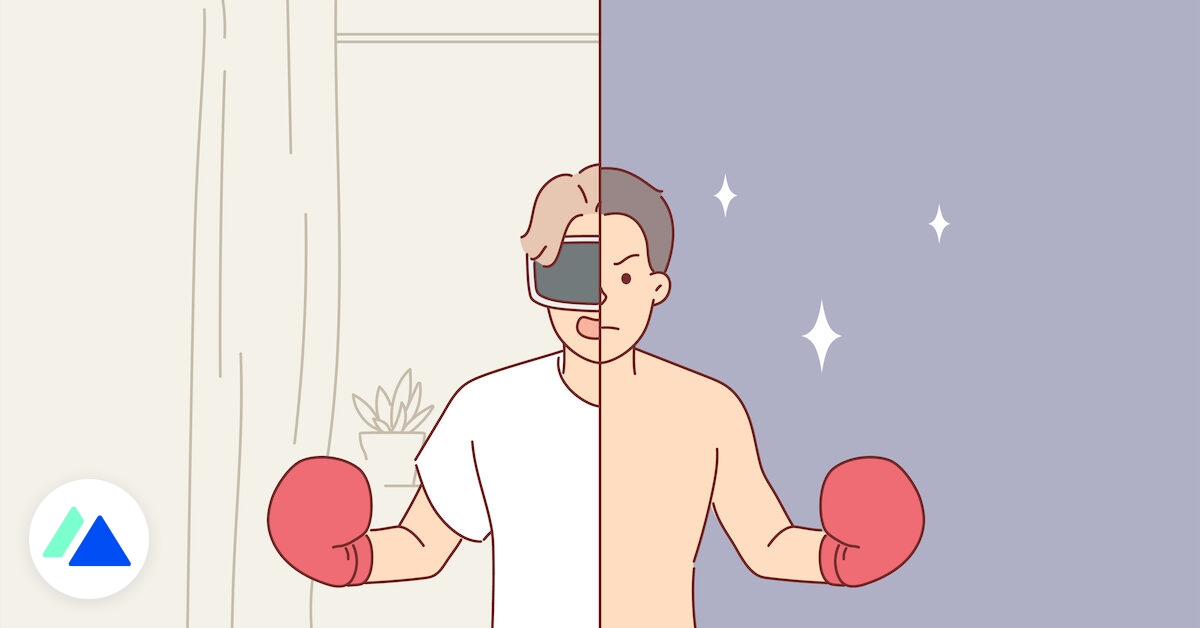Combler l’écart entre l’urgence de la performance sportive et le temps nécessaire à la recherche : tel était l’enjeu du programme prioritaire de recherche (PPR) « Sport de très haute performance », lancé en 2020. Financé à hauteur de 20 millions d’euros, ce programme visait à accélérer le rapprochement entre les entraîneurs, les athlètes et les chercheurs pour atteindre les objectifs de médailles fixés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En d’autres termes, il devait permettre d’identifier des solutions innovantes pour couvrir les besoins des sportifs de haut niveau, notamment en matière de récupération, de parcours d’entraînement ou d’optimisation des gestes. Pour qu’ils soient en mesure de repousser encore plus loin les limites de leur corps et de leur l’esprit, et fassent rayonner la France à l’échelle internationale.
Parmi les technologies envisagées pour maximiser les performances figurait, notamment, la réalité virtuelle, qui a été placée au cœur d’un projet nommé REVEA. Doté d’un budget de 1,1 million d’euros, ce programme, piloté par l’Université de Rennes 2 et soutenu par l’équipe MimeTIC de l’Inria, avait pour principal objectif d’optimiser l’entraînement des boxeurs olympiques tout en limitant les risques de blessures.
Lors de la conférence intitulée « Innovations olympiques », organisée dans le cadre d’Imagine Summit, Franck Multon, directeur de recherche à l’Inria, en a détaillé les principaux contours, tout en dépeignant, plus largement, les atouts de cette technologie dans le sport de haut niveau. BDM l’a rencontré en marge de l’événement.
« La réalité virtuelle ne peut pas tout faire, mais peut rendre service dans la majorité des activités physiques »
Analyse des stratégies, entraînement sans risque de blessures, simulation de scénarios, répétition des gestes : sur l’estrade de la Nef, l’auditorium du Couvent des Jacobins où se sont enchaînées les interventions d’acteurs du monde de l’innovation ce jeudi 5 décembre 2024, Franck Multon n’a eu aucun mal à vanter les atouts de la réalité virtuelle qui offre, selon lui, de nombreuses applications dans le sport de haut niveau. Notamment pour la boxe, une discipline qui a mobilisé son équipe durant plusieurs mois.
« L’entraîneur de l’équipe de France olympique de boxe nous a posé cette problématique : comment entraîner les athlètes à la défense sans qu’ils subissent de coups ? », raconte-t-il, lors d’un entretien accordé à BDM en marge de l’événement. Pour relever ce défi, l’Inria et l’Université de Rennes 2 ont conçu un système d’entraînement en réalité virtuelle qui immerge l’athlète dans un environnement fictif et entièrement paramétrable. Sur ce ring virtuel, le boxeur peut s’exercer à parer, esquiver ou contre-attaquer face à un avatar, et ce, sans risque de blessures. Un dispositif qui a rapidement convaincu, y compris l’entraîneur.
Si les avantages de la réalité virtuelle dans une discipline à risque, comme la boxe, peuvent sembler flagrants, cette technologie n’a rien d’unidimensionnel. Elle permet de développer de nombreuses « sous-compétences », en fonction de la discipline. « Elle rendra service dans la majorité des sports. Chaque discipline va avoir ses challenges », estime Franck Multon.
Le chercheur prend l’exemple de la gymnastique, où la VR facilite l’apprentissage des enchaînements et permet d’apprendre à se positionner. « Des partenaires du projet REVEA, à Reims, ont créé un système de réalité virtuelle qui permet à l’athlète de s’immerger dans sa propre performance, avec des arrêts sur image sous différents angles, à la manière de Matrix. C’est un réel accélérateur d’apprentissage ». La réalité virtuelle trouve aussi des applications dans le cyclisme, pour entraîner les coureurs à anticiper les attaques dans le peloton. « Avec la réalité virtuelle, on peut créer un peloton et divers scénarios, avec des attaques partant de la gauche, de la droite, avec ou sans levée de selle », complète-t-il.
Une « dichotomie entre l’exigence de résultats et le temps nécessaire à la recherche »
Mais alors, malgré toutes ces qualités, pourquoi la réalité virtuelle, qui suscite l’intérêt du monde universitaire et scientifique depuis le début des années 2000, a-t-elle tardé à s’inviter dans les programmes d’entraînement ?
Enseignant-chercheur dans le domaine du sport et de la science depuis 25 ans, après avoir soutenu une thèse en informatique « sur le mouvement humain et la simulation avec des avatars », Franck Multon a observé l’évolution du regard porté sur l’intégration de la technologie dans le sport. Et il est catégorique : ce qui sonne aujourd’hui comme une évidence, dans un monde obsédé par l’optimisation et les gains marginaux, ne l’était pas il y a quelques années. « Cela fait 25 ans qu’on essaie de rapprocher les scientifiques des sportifs, mais ça ne prend pas, se remémore-t-il. Des projets magnifiques ont été lancés, ici ou là, mais il y avait toujours une différence de discours et de temporalité entre les deux mondes. Il y avait aussi une forme de défiance de la part des entraîneurs, qui avaient peur d’être contredits, mais aussi des chercheurs, qui craignaient que leurs résultats soient mal interprétés ».
Franck Multon en est convaincu : l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024 a agi comme un catalyseur, en poussant les acteurs du monde du sport et de la recherche à « se mettre autour de la table » pour échanger sur leurs attentes, leurs craintes et leurs besoins. « Sans ces programmes prioritaires de recherche, les projets innovants dans le sport de haut niveau seraient toujours difficiles à mettre en place, malgré les efforts de rapprochement », admet l’enseignant-chercheur. Outre les incompréhensions et les malentendus, la réalité virtuelle a tardé à se démocratiser car elle manquait, aussi, d’ambassadeurs chez les coachs et les sportifs les plus médiatisés.
Quand un sportif ou un entraîneur de très haut niveau invite à se renseigner sur notre travail, ça change tout.
Un impact sur le grand public ?
Aujourd’hui pleinement intégrées dans le sport de haut niveau, ces innovations, qui ont été conçues pour atteindre des objectifs élevés dans un délai très court, pourraient aussi profiter au grand public, « de la même manière que la Formule 1 stimule l’innovation chez les constructeurs automobiles », souligne l’enseignant-chercheur.
À court terme, la réalité virtuelle pourrait aider à combattre la sédentarité, grâce au développement de serious games reproduisant virtuellement certaines disciplines sportives. « On pourrait imaginer des combats de boxe en VR, sans blessures, et vendre ça comme un spectacle », estime-t-il, tout en poursuivant le développement de solutions pour le haut niveau. Mais pour cela, il faudra que ces projets trouvent d’autres financements, ou qu’ils « soient associés à des industriels ». À plus long terme, ces « briques technologiques » pourraient aussi permettre de répondre à des problématiques spécifiques, qui n’ont encore été identifiées, notamment dans le domaine de la rééducation. L’innovation ne serait alors plus uniquement olympique.