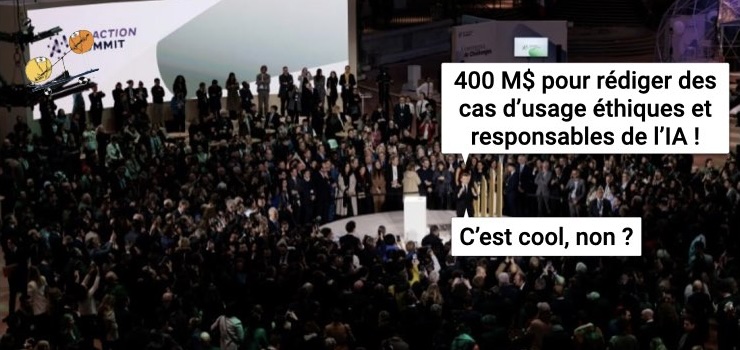En ce début d’année, la France accueillit tout le gratin politique et économique mondial à l’occasion du Sommet sur l’action pour l’IA. Mais ça, c’était la semaine dernière, car depuis l’attention des médias s’est déplacée vers les négociations pour la paix en Ukraine, les probabilités pour que l’astéroïde YR4 s’écrase sur la lune en 2032 ou la sortie de Grok 3. Dans un tel climat d’incertitude et de frénésie médiatique, les citoyens comme les salariés ont bien du mal à se projeter dans un futur où l’IA va faciliter leur quotidien. Et ce n’est pas l’action des politiques ou de consultants externes qui va arranger les choses…

En synthèse :
- Si le Sommet pour l’action sur l’IA est indéniablement un succès médiatique et géopolitique, son impact sur les citoyens et salariés français reste à prouver, car il semble avoir exacerbé les peurs relatives à l’IA et le ressentiment à l’égard des nouvelles technologies ;
- Les discours très optimistes et paradoxalement très alarmistes des éditeurs d’AI générative sur les bénéfices qu’apportent leurs solutions participent à un sentiment général de méfiance qui perturbe fortement leur adoption (mauvaise disposition psychologique et émotionnelle) ;
- Le rythme d’innovation effréné des modèles et solutions d’IA générative rend caduque toute tentative de lister les cas d’usage les plus pertinents, car ils seront obsolètes au bout de quelques mois ;
- L’important n’est pas de montrer aux collaborateurs ce qu’ils peuvent / doivent faire, mais de leur donner les moyens d’être autonomes dans leur découverte et leur montée en compétences sur l’IA générative ;
- L’adoption de l’IA ne relève pas de la formation à de nouveaux outils, mais d’une conduite du changement pour préparer les collaborateurs à la 4e révolution industrielle.
Le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle qui s’est tenu ce mois-ci à Paris et a été un grand succès avec des participants venus de plus de 100 pays et une très large couverture médiatique. Cet événement a notamment été l’occasion pour les grands de ce monde d’officialiser un certain nombre d’initiatives relatives à l’IA : Les actions de Paris pour l’intelligence artificielle.

Parmi toutes les annonces liées à ce sommet, nous pouvons retenir la signature de la Charte de Paris pour une intelligence artificielle d’intérêt général, un nouveau partenariat pour promouvoir l’IA d’intérêt général, et une initiative locale dotée de 400 M € pour développer et en soutenir les projets qui servent l’intérêt public avec un site web (CurrentAI.org) où l’on peut lire des phrases choc comme « Real impact, real lives« , « We Support Change Through Global Network » ou encore « The opportunty to shape AI’s future is now« .

OK.
…
…
Super.
…
…
Et alors ?
…
…
S’il ne fait pas de doute que cet événement a bénéficié d’une très grosse couverture médiatique, la question se pose de savoir ce qu’il va ressortir concrètement de ce sommet. Non pas que je verse dans la facilité à faire du french bashing, mais maintenant que l’événement est passé, je constate beaucoup d’attentisme, car les entreprises et organisations restent dans le flou : vont-elles être subventionnées par l’UE ou pénalisées par l’IA Act ? Difficile à dire, car ces questions ont été éclipsée par les déclarations ambiguës des différents chefs d’états (Anthropic CEO Dario Amodei calls the AI Action Summit a ‘missed opportunity’). Le bilan de ce Sommet pour l’action sur l’IA est donc plutôt mitigé, car si les objectifs de couverture médiatique ont été largement atteints, la dimension pédagogique a été clairement négligée.
Entendons-nous bien : je suis très content et fier que cet événement ai été organisé à Paris (et non à Londres ou Berlin), mais le fait est qu’un événement médiatique en chasse un autre : l’attention des médias est maintenant focalisée sur le processus de paix en Ukraine et sur un nième scandale de politique intérieure. Tout ceci bien évidemment dans l’attente d’une nouvelle catastrophe naturelle ou d’un autre attentat terroriste. Ainsi va le monde en 2025 : une breaking news en chasse une autre…
Comme le dit le proverbe : il n’y a pas de mauvaise publicité. Le coup de pouce politico-médiatique de ce Sommet est en théorie une bonne chose pour faire progresser les investissements et l’adoption de l’IA, mais l’impact réel est à nuancer et surtout à relativiser. Le problème est que l’adoption de l’IA générative à marche forcée imposée par les éditeurs était déjà très perturbante pour les entreprises et salariés, car elle mettait en exergue d’énormes zones grises technologiques, fonctionnelles et juridiques. La reprise en main par les chefs d’État du sujet de l’IA n’est pas forcément une bonne chose, car cela ne fait que rajouter un facteur politique à une équation déjà très complexe.
Le nouveau “truc à Macron”
Encore une fois, je tiens à préciser qu’il est difficile de critiquer l’implication de notre Président sur ce dossier, car il a réellement donné de sa personne pour promouvoir le savoir-faire français an matière d’IA, que ce soit lors de son interview télévisée ou de ses interventions publiques. On a ainsi pu voir Emmanuel Macron prêcher la bonne parole (technologique), tel un Marc Benioff à Dreamforce. Mais je ne suis malheureusement pas certain que l’enthousiasme du président ait été bien perçu par le français lambda…

Ainsi, après avoir défendu avec acharnement la « startup nation », force est de constater que la « Nation IA » laisse perplexe, surtout pour les foyers à revenus modestes qui ne comprennent pas forcément d’où viennent les 109 MM$ annoncés alors que les hôpitaux et les écoles sont au bord du gouffre (cf. Faire de la France une puissance de l’IA).
Rassurez-vous, je ne suis pas là que pour critiquer (je vous rappelle que j’ai moi-même oeuvrer à ma petite échelle pour le rayonnement du savoir-faire français en matière d’IA : Compte-rendu Chine #1 – usages mobiles). Pour faire justice à ce Sommet sur l’action pour l’IA, disons que la bonne clé de lecture est de considérer que cet événement n’avait pas pour vocation de fédérer les (contribuables) Français, mais de rassurer les (investisseurs) étrangers.
Le problème est que l’un a des conséquences sur l’autre : cela fait plus de 10 ans que je m’intéresse au sujet du machine learning et je peux vous affirmer que l’intelligence artificielle est un sujet terriblement anxiogène qu’il faut aborder avec précaution afin d’éviter d’aggraver la peur du changement : L’intelligence artificielle fait peur, surtout à ceux qui ne font pas l’effort de la comprendre.
Je pense ne rien vous apprendre en écrivant qu’il existe un sentiment général plutôt négatif vis-à-vis de l’IA, notamment lié à une peur persistante d’appauvrissement intellectuel, et donc de déclassement des salariés qui passeraient du statut de professionnels ayant des compétences dans un domaine précis à simples surveillants d’IA : GenAI turns knowledge workers from problem solvers to AI output verifiers, says Microsoft study.

Nous sommes ici face à une très banale histoire de conduite du changement, ou plutôt de résistance au changement. Ce qu’il faut retenir de tout ceci est qu’il y a un gros besoin pédagogique pour expliquer ce qu’est l’IA auprès du grand public et éviter la confusion et les ressentiments (ex : « Macron sait trouver des centaines de milliards pour l’IA, mais est incapable de résoudre mes problèmes« ).
Quelque part, ce Sommet de l’action pour l’IA met en évidence la fracture numérique qui s’élargit avec l’avènement de l’intelligence artificielle, et que les Cafés IA vont avoir bien du mal à combler… J’ironise, pourtant les ressources pédagogiques mises à disposition dans le cadre de ce dispositif sont très pertinentes, mais encore faut-il que les citoyens fassent l’effort. Or, je ne suis pas certain qu’ils soient dans de bonnes dispositions tant le sujet a été saccagé par les médias.
Idem dans le monde de l’entreprise où l’adoption est censée accélérer alors qu’elle stagne.
Une adoption freinée en entreprise par la dette numérique
Depuis la sortie de ChatGPT à la fin de l’année 2023, tous ceux qui s’intéressent ou non au sujet de l’IA générative ont été abreuvés par un flot incessant de promesses de gains de productivité : que ce soit au niveau individuel ou collectif, les modèles génératifs nous sont présentés comme des outils magiques capables de nous épargner des tâches laborieuses et nous faire ainsi gagner de nombreuses heures dans nos journées de travail.
Les premières études publiées l’année dernière nous montraient ainsi une adoption de surface (Baromètre 2024 IFOP pour Talan « les français et les IA génératives »), mais les transformations structurelles prophétisées par les grands cabinets conseil se font encore attendre, car si 43 % des salariés déclaraient utiliser régulièrement les modèles génératifs en juin 2024, seuls 42% déclaraient être confiants quant à l’impact des IA sur leur travail (IA Générative au travail : amie ou ennemie des salariés ?).

Aujourd’hui, la pression exercée par les éditeurs et cabinets conseil est toujours aussi forte avec des études récentes qui s’efforcent de faire preuve d’optimisme (montrer le verre à moitié plein), mais qui peinent à nous convaincre que la révolution de l’IA générative est en cours :

Ce que révèlent ces études est que les statistiques binaires et déclaratives qui sont mises en avant ne sont pas le reflet de la réalité des entreprises (ex : « Utilisez-vous l’IA ?« ). Voilà deux ans que j’accompagne des organisations de différents secteurs et différentes tailles dans leur adoption de l’IA générative et je peux vous affirmer que le problème est toujours le même : il y a d’énormes écarts de maturité numérique / informatique entre les salariés qui fait qu’en l’absence d’un programme ambitieux, la découverte et l’adoption de l’IA générative est avant tout une démarche personnelle et volontaire (La dyspraxie numérique est un frein majeur à votre transformation digitale). Ceux qui n’ont ni la volonté, ni la curiosité n’ont aucune chance de se mettre spontanément à utiliser l’IA générative.
Formulé autrement : face au sentiment d’urgence inculqué par les éditeurs de solution d’IA (il faut aller vite, sinon c’est la catastrophe assurée), personne ne sait par où commencer ni quoi faire : ni les directeurs, ni les managers, ni les salariés. Il y a un réel problème de « démarrage à froid » qui ne peut être résolu qu’avec un plan ambitieux d’acculturation et de formation : La maitrise des prompts est une étape indispensable à l’adoption de l’IA générative.
L’excuse des cas d’usage pour s(t)imuler l’adoption
Quiconque travaillant dans le domaine du numérique ou de l’informatique est formel : l’IA pour faire de l’IA ne sert à rien, l’important est de définir des cas d’usage.
…
…
OK.
…
…
Et alors ?
…
…
Depuis l’année dernière, définir des cas d’usage semble être la nouvelle activité à la mode, celle à laquelle s’adonnent tous les cabinets conseils et ESN. Autant l’écrire tout de suite : je suis extrêmement sceptique quant à l’utilité de cette démarche, car c’est surtout une façon pour les entreprises de montrer que l’on s’intéresse et que l’on est actif sur le sujet… sans prendre de risque puisque l’on ne fait rien de concret si ce n’est produire de la documentation sur des technologies et usages qui seront caducs dans 6 mois du fait d’un rythme d’innovation très élevé.

Décrire des usages potentiels est une démarche pédagogique plutôt légitime, mais le problème est que la majeure partie des cas d’usage modélisés ne font que formaliser des tâches banales qui font déjà partie du quotidien des collaborateurs : ça ne les fait non seulement pas rêver, mais ne plus cela génère un sentiment de méfiance vis-à-vis de ce qui est perçu comme de l’ingérence dans leur travail au quotidien.
J’ai une approche pédagogique différente qui met l’accent sur le transfert de connaissance (comprendre) et de compétence (savoir faire) plutôt que sur le mimétisme (voilà ce que vous pouvez faire et comment le faire). L’IA générative ne doit pas être présentée comme un gadget qui peut rendre des services (ex : rédiger des comptes-rendus de réunions ou traduire / adapter des articles), mais comme une occasion de revoir nos façons de travailler : une nouvelle façon d’exploiter les ressources informatiques pour se libérer de l’héritage néfaste des outils bureautiques (ne pas chercher à créer encore plus d’emails ou de fichiers, mais au contraire de s’en affranchir : L’IA pour restructurer les informations et données).
Ce parti-pris pédagogique repose sur la prise en compte de problématiques (« Quel est le problème que vous essayez de résoudre ? ») pour pouvoir capter l’attention des collaborateurs et les motiver à changer d’habitudes et à s’intéresser aux outils reposant sur l’IA générative. Toute la difficulté étant que les outils et pratiques se périment très vite : ce qui est valable aujourd’hui sera périmé dans 6 mois. Pour vous en convaincre, il vous suffit de constater qu’il y a trois mois, personne n’avait réellement pris conscience de l’existence de modèles frugaux (ex : Deep Seek), de modèles de raisonnement (ex : o1, o3, R1…) ou de recherches avancées (« Deep Research »).

L’essentiel de la pédagogie ne doit pas concerner les outils en eux-mêmes, mais la compréhension des enjeux de la transformation en cours ainsi que l’appréhension de nouvelles habitudes de travail reposant sur un binôme salarié / IA, pas sur des tâches banales que l’on souhaite sacraliser et « processiser » (ex : systématiquement générer des comptes-rendus de réunion).
L’important n’est pas de former les collaborateurs à ce qui existe, mais de la préparer à ce qui va arriver : se concentrer sur l’évolution des mentalités et non l’optimisation de tâches à faible valeur ajoutée.
De l’importance d’apprendre à apprendre
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’expliquer dans de précédents articles : les outils reposant sur les modèles génératifs offrent des gains de performance potentiellement intéressants… pour ceux qui vont savoir s’en servir dans leur contexte professionnel (De l’intérêt d’outils intégrés et maitrisés pour faciliter l’adoption de l’IA), ce qui est très loin d’être le cas pour la majorité des collaborateurs, quel que soit leur âge ou activité (Nous n’avons pas besoin de meilleures IA, mais d’une meilleure compréhension de l’IA).
Encore une fois, je parle d’expérience, celle accumulée ces deux dernières années à discuter, former et accompagner de nombreuses entreprises et organisations dans leur adoption de l’IA : les outils reposant sur les modèles génératifs exposent au grand jour la dette numérique des entreprises, ainsi que le besoin en acculturation numérique, voir informatique. Croyez-le ou non, mais je me retrouve souvent à devoir faire des formations au prompting auprès de salariés qui ont bien du mal à se servir de leur ordinateur (ils n’arrivent généralement pas à créer un compte sur ChatGPT ou ne se souviennent pas de leur mot de passe Microsoft et ne parviennent pas à la réinitialiser).

Face à ces difficultés, la tentation est grande de chercher à faciliter l’adoption avec des cas d’usage bien documentés, mais cela ne fait que rajouter du formalisme (documents, procédures…) là où il y en a déjà beaucoup trop. Je suis ainsi persuadé que l’approche par les cas d’usage n’est pas viable, car vous pouvez passer des années à identifier tous les cas d’usage possibles sans pour autant fournir une bonne raison à vos collaborateurs de changer leurs habitudes (car on se contente de leur expliquer comment faire plus avec moins).

J’insiste sur le fait que l’important n’est pas de montrer comment pomper plus vite (ex : générer de beaux emails à partir d’une liste à puces, synthétiser un long email en une liste à puces…), mais de leur expliquer les capacités et limites des modèles génératifs afin qu’ils puissent se forger leurs propres convictions sur la meilleure façon d’améliorer leur quotidien : d’intégrer l’IA générative à leurs processus et habitudes de travail. En gros : les rendre autonomes plutôt que de les infantiliser à travers des cas d’usage qui leur expliquer quoi et comment faire leur travail.
Celles ou ceux qui pensent qu’ils vont pouvoir faire la révolution de l’IA en quelques mois sont soit très naïfs, soit très éloignés de la réalité du quotidien des travailleurs du savoir, les cols blancs (cf. La bataille du cloud se gagnera bureau par bureau). Ne vous y trompez pas : le déploiement à grande échelle de l’IA générative et l’adoption de nouvelles habitudes de travail est un chantier titanesque qui va prendre des années, d’autant plus que l’on essaye de moderniser le moteur d’une voiture tout en continuant à rouler.
Pour être quotidiennement confronté à ce défi, j’ai acquis la conviction que l’adoption de l’IA par l’ensemble des collaborateurs exige un travail d’accompagnement sur le long terme avec un soutien indéfectible de la hiérarchie. Un dispositif lourd qui ne peut être viabilisé qu’avec des ressources internes. Est-ce que ça signifie des coachs IA, au même titre qu’il existe des coachs agiles ? Pourquoi pas, car il y a bien des référents numériques ! Cette notion d’accompagnement de proximité dans l’appréhension et l’adoption de l’IA est donc potentiellement une extension du périmètre de leurs attributions.
Comme quoi, ce qui nous est présenté comme la « révolution disruptive de l’IA » n’est en réalité que la prolongation du processus de transformation numérique entamé il y a de nombreuses années : L’IA n’est qu’un moyen d’achever votre transformation numérique.