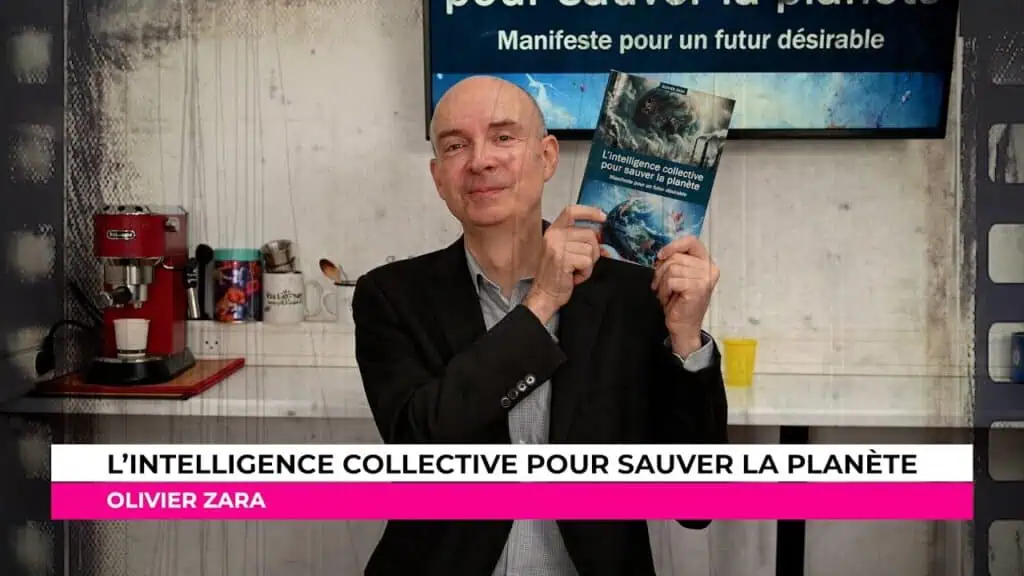Podcast: Play in new window | Download (Duration: 18:45 — 12.8MB)
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Android | | More
J’ai reçu Olivier Zara il y a quelques semaines pour parler de son dernier ouvrage intitulé l’intelligence collective pour sauver la planète. Mais face à l’accumulation de messages anxiogènes d’une part, et la multiplication des attitudes et comportements antiécologistes d’autre part, peut-on encore espérer que nous sortions des blabla politiques pour entrer véritablement dans l’action ? La réponse est positive selon Olivier. Il nous enjoint de faire confiance à l’intelligence collective au niveau local pour résoudre des problèmes trop complexes et conséquents pour le niveau mondial. En 18 minutes chrono, voici ses arguments « cash » pour vous convaincre de garder l’espoir et agir pour la planète et ses enfants.
Intelligence collective : peut-on encore sauver la planète ?

Au tout début de l’Internet, une vidéo virale circulait. C’était un vieux pépé en chapeau qui expliquait l’intelligence collective. Je l’ai retrouvée pour vous.
— « Qu’est-ce que l’intelligence collective », disait-il devant la caméra
— « Tout le monde connaît la c***erie collective » poursuivait-il, assez facétieux, « on la rencontre dans un dîner, une réunion de famille, au bureau… »
Et de conclure,
— « Et bien l’intelligence collective, c’est le contraire ! »
Et il levait son verre (rempli modérément comme il se doit), à notre santé.
Cette boutade m’est revenue en écoutant le discours de mon ami Olivier Zara, en ce début d’année. Je partage comme lui, et ce depuis ma prime jeunesse, une conscience que je pourrais nommer écologique. Non du fait d’une quelconque appartenance à un parti politique, dont je ne dirai rien ici. Rien à voir donc, l’écologie est l’art d’étudier — pour mieux la gérer — la « maison ». Notre maison, la Terre. Et je note que celle-ci ne me paraît pas très propre, c’est un euphémisme.
L’écosystème, c’est, littéralement, la « maison » de la vie, et la science qui l’étudie, l’écologie. Ce terme a été créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel à partir du grec oikos, la maison, et logos, la science. Elle étudie les relations qui existent entre les êtres vivants et le milieu où ils vivent.
Rosnay, Joël de. Le Macroscope. Vers une vision globale (Points Sciences — Seuil), 1975.
Le discours d’Olivier m’a bien plu. Sans fard et chargé d’ironie. Et il en faut de l’ironie pour s’attaquer à l’immobilisme et au scepticisme. Mais il apporte plus que cela. Une approche, peut-être un peu utopique, basée sur l’intelligence collective (dont vous connaissez maintenant la définition), pragmatique et sans chichis.
Ce sont les rêves qui poussent les humains aux grandes choses. Alors, continuons à rêver, et peut-être que cette intelligence collective nous aidera à sauver notre petite maison.
Voici l’interview d’Olivier, sans censure ni tabous, et souhaitons qu’elle fasse réfléchir les marketeurs que nous sommes. Après tout, on ne vend pas grand-chose dans une maison en ruines.

Pourquoi la transition écologique doit-elle être locale ?
La transition écologique sera locale ou ne sera pas.
Nous sommes submergés, au moins 3, 4, 5 fois par jour, d’informations sur l’urgence d’agir pour le climat. Et pourtant, malgré ce niveau de conscience, on n’a toujours pas le sentiment d’être dans l’action. Alors, que faire ?
Le problème est mondial et donc, logiquement, on se dit qu’il faut agir à ce niveau. Et dans le même temps, à chaque COP, on assiste au bureau des pleurs. Et on se dit qu’on n’est pas sorti d’affaire.
Ainsi, l’Union européenne concocte son Green Deal en 2019 pour expliquer qu’en 2035, il n’y aura plus de voitures thermiques. Moins d’un an après cette mesure phare, la Pologne, l’Allemagne et l’Italie font pression sur l’UE pour faire machine arrière sur la voiture électrique.

Quelques centimes et c’est déjà trop…
Alors on se rabat sur le niveau national. Et on décide de mettre en place une taxe carbone de quelques centimes sur le carburant. Et c’est la révolte des gilets jaunes.
Mais pas de problème, on organise une petite convention citoyenne du climat ; en se disant que les débats seront « sans filtre ». Résultat, les recommandations sont finalement vidées de leur substance ou réduites à leur plus simple expression.
La folie c’est faire toujours la même chose…
Il y a une citation attribuée à Einstein que j’aime bien :
La folie c’est faire toujours la même chose et s’attendre à un résultat différent
Si au niveau international, les COP ne fonctionnent pas, si au niveau européen, ça ne fonctionne pas, si au niveau national, dès qu’on fait quelque chose d’un peu puissant, ça ne fonctionne pas non plus, que nous reste-t-il ? Le niveau local.
C’est la thèse et l’angle de mon livre. Il faut changer le centre de gravité et sortir des tours d’ivoire.
Les instances nationales et supranationales déversent des réglementations et des plans d’adaptation sur leurs administrés de manière descendante. Et les citoyens se demandent « pourquoi ? »
On vient heurter des biais cognitifs, le biais pour le présent, le biais d’intérêt, le biais d’aversion pour le risque, le biais de statu quo. Le résultat, c’est une résistance qui s’instaure.
Il faut donc agir au niveau local et travailler en dynamique d’intelligence collective. Il faut co-construire, au niveau local, la façon dont on va vivre ensemble dans les prochaines années.
Qu’entend-on par « niveau local » ?
Il est une loi bien connue des journalistes, la loi du mort-kilomètre.
Vaut-il mieux parler de 10 000 morts à 10 000 km ou d’un mort à 1 km ? Les journalistes sont formés à parler du mort à 1 km, car cela parle plus à leurs audiences.
Ainsi, quand on explique que la taxe carbone consiste à augmenter les prix de 4 centimes pour sauver la planète en 2100, ça ne parle à personne.
Par contre, si l’on me dit que je peux co-construire un futur désirable, de nouveaux modes de vie, de consommation, proche de chez moi, dans pas longtemps, je commence à percevoir les bénéfices potentiels de l’action. Surtout si cette co-construction s’envisage avec des gens qui me ressemblent, qui sont proches de moi, à qui je peux m’identifier.
L’échelle locale peut être une ville, une communauté de communes, un bassin de vie… Une ville, que je nomme franche, qui a une certaine autonomie et un écosystème propre.

Comment définir l’innovation dans ce contexte ?
Je distingue deux types de projets.
- D’abord les projets de statu quo. On y parle en termes de réduction, la réduction des gaz à effet de serre, par exemple. On y parle de restauration, de préservation. « Il faut reboiser », par exemple. C’est une bonne chose, car cela est censé ralentir la catastrophe climatique. Mais pour moi, c’est se tromper d’objectif. Ces projets de restauration, de limitation, de réduction sont importants, mais il faut maintenant en faire notre deuil. Les changements que nous vivons sont immuables.
- Il faut donc aller au contraire sur des projets d’adaptation. Et l’adaptation, pour moi, cela ne consiste pas à faire une digue ni à reboiser. Ça, c’est du statu quo, c’est d’essayer de rester le plus proche possible de nos modes de vie actuels. Quand je parle d’adaptation, je parle de résilience. Ces phénomènes climatiques, d’inondations, de feux de forêt, de pénuries alimentaires… tout cela est inévitable. Il nous faudra nous adapter, réinventer, innover dans nos façons de consommer, de nous déplacer, de construire, etc.
L’adaptation c’est la résilience, et pour cela il nous faudra innover.
Pour moi, un projet d’adaptation, c’est un projet dans lequel il faut innover, inventer. On pourrait parler de « pragmatopie ». Il nous faudra être à la fois pragmatiques et utopiques.
Qui parle innovationL’innovation va de la compréhension (intuitive ou non) du comportement de l’acheteur à la capacité d’adaptation à l’environnement, parle également de courbe de l’adoption de l’innovation de Rogers. Avec les adopteurs et les suiveurs précoces, les suiveurs tardifs, etc.
Quand le chemin de fer est arrivé, certaines villes n’ont pas voulu du chemin de fer parce que ça allait faire du bruit et de la fumée.

Donc l’idée, c’est de commencer par des villes, les élus et les citoyens qui sont les adopteurs précoces et qui sont prêts à se muer en laboratoire d’innovation publique. Et ces villes, ces élus et ces citoyens auront une grande autonomie écologique et vont inventer de nouvelles façons de se nourrir, de se déplacer, de construire. Évidemment, certaines choses ne fonctionneront pas, il y aura des échecs et des ratés.
Intelligence collective : changer le centre de gravité de la transition écologique
Ce que je souhaiterais, c’est qu’on change le centre de gravité qui est aujourd’hui encore national ou européen ou international. Ceux-là sont dans leur tour d’ivoire et balancent des « il faut faire ci, il faut faire ça ». Ils pratiquent ce que d’aucuns nomment l’écologie punitive. Il faut donc changer le centre de gravité et se dire que le leader de la transition écologique, c’est le niveau local. Et les niveaux national et international doivent se mettre au service du local.
Ensuite, il faudra regarder les innovations qui ont fonctionné et essayer de les déployer dans les villes, les communautés ou les territoires qui n’ont pas voulu être à la pointe de l’expérimentation. Dès lors, on pourra être plus directif. On montrera comment les pionniers ont réduit leur consommation de viande ; et comment ils ont optimisé et réduit leur bilan carbone. Nous montrerons que ces pionniers-là vivent autrement et qu’ils vivent mieux. Ensuite, on pourra imposer cette solution au niveau national et international.
La transition écologique sera locale ou elle ne sera pas.
Existe-t-il déjà des exemples de ce que tu proposes ?
Oui, il y a « Fab City », un réseau de villes au niveau international, qui prévoit pour 2054 d’être complètement autonomes. Elles souhaiteraient, à horizon 2054, être capables de produire tout ce dont ils ont besoin pour vivre avec des imprimantes 3D. C’est Barcelone qui est à l’initiative de ce projet.
C’est exactement dans l’esprit de ce que je propose. J’appelle cela des villes franches. Parce que je voudrais qu’on leur donne à peu près la même autonomie que celle qu’on donne à une province au Canada, à un land en Allemagne ou à un canton en Suisse.
C’est que la fondation « Fab City » est en train de faire. Mais elles sont broyées, écrasées par des réglementations internationales, européennes et nationales. Et ainsi, elles sont bridées dans leur capacité à innover. C’est comme si on nous disait « tu peux innover, mais voici toutes les barrières, tous les freins que tu as et qui te brident. »
Je voudrais simplement libérer le potentiel de ces communautés, de ces territoires, pour pouvoir accélérer les choses.
Penses-tu que la technologie va nous sauver ?
En fait, je n’en sais rien. Tant mieux si ça arrive. Je le souhaite sincèrement, je ne suis pas un technophobe, mais je ne ferai pas ce pari.
Alors que tout le monde cherche des technologies salvatrices, pourquoi pas. Mais cela ne peut pas être le plan A, c’est juste un plan B.
Le plan A, c’est sur ces territoires autonomes, comment on peut transformer quelques territoires en laboratoire d’innovation publique, pour qu’ils co-construisent, qu’ils inventent. C’est ce que j’appelais la « pragmatopie », ce terme n’est pas de mon invention.
Qui doit prendre l’initiative de créer ces villes franches ?
Au démarrage, quand même, il faut une initiative politique. Évidemment, dans un état très centralisé, comme en France, ce concept de ville franche avec une autonomie écologique est moins évident.
Avec une perspective mondiale par contre, c’est plus logique. Si on propose cette idée au Québec, en Scandinavie ou en Allemagne, où il y a déjà trois villes qui sont des länder (Berlin, Brême et Hambourg qui y sont nommés des Stadtstaaten), on risque d’avoir une plus grande réceptivité.
L’impulsion politique au démarrage est nécessaire pour donner le cadre en fait d’autonomie.
Une transition obligatoirement démocratique
Et ensuite de ça, tout à l’heure, je disais que la transition écologique serait locale ou ne serait pas. Mais la transition écologique sera également démocratique ou elle ne le sera pas.
De ce fait, à un moment donné, il faudra passer par des référendums. Un peu à l’image de ce qu’on fait avec les « votations » en Suisse. Sur des choix de société comme la consommation de viande, sur les mobilités, sur les logements, on ne peut pas imposer cela par la force, le changement doit se mener démocratiquement.
Et ceux qui sont contre les innovations pourront toujours aller habiter ailleurs.
Pourquoi sommes-nous bloqués dans l’inaction climatique ?
Il est vrai qu’aujourd’hui, l’impulsion politique va dans le mauvais sens. Il y a bien des causes à cela que j’explique dans le livre. J’en donne neuf, il y en a peut-être davantage.
Une de ces causes, c’est la recherche du consensus. Jean-Claude Juncker disait : « Les responsables politiques savent très bien ce qu’il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ils ne savent pas comment être réélus s’ils le font ».
Donc, Trump arrive au pouvoir en 2017, et il sort brutalement des accords de Paris. Biden revient et valide à nouveau les accords de Paris, puis Trump revient en 2025 et sort à nouveau des accords de Paris. On parle quand même du pays qui pollue le plus dans le monde.
C’est pour cela que je pense qu’il est plus pragmatique et plus réaliste de donner une autonomie aux villes.
Intelligence collective : encore des raisons d’espérer ?
Absolument, sinon, je n’aurais pas pris le temps d’écrire ce livre, même si souvent, on fait tout l’inverse de ce qui doit être fait.
Le message d’espoir, c’est qu’il suffit de peu pour donner de l’autonomie écologique à des villes. Co-construire, hybrider des solutions qui se situent entre utopie et pragmatique, à faire voter par la population en mode référendaire. Avec ces solutions qui émergeront, on pourra refondre entièrement les processus décisionnels pour les amener au niveau local. Et non plus international ni même national.
Nous avons donc vraiment des raisons d’espérer que, dans les 50 prochaines années, on fasse tout l’inverse de ce qu’on a fait dans les 50 dernières.