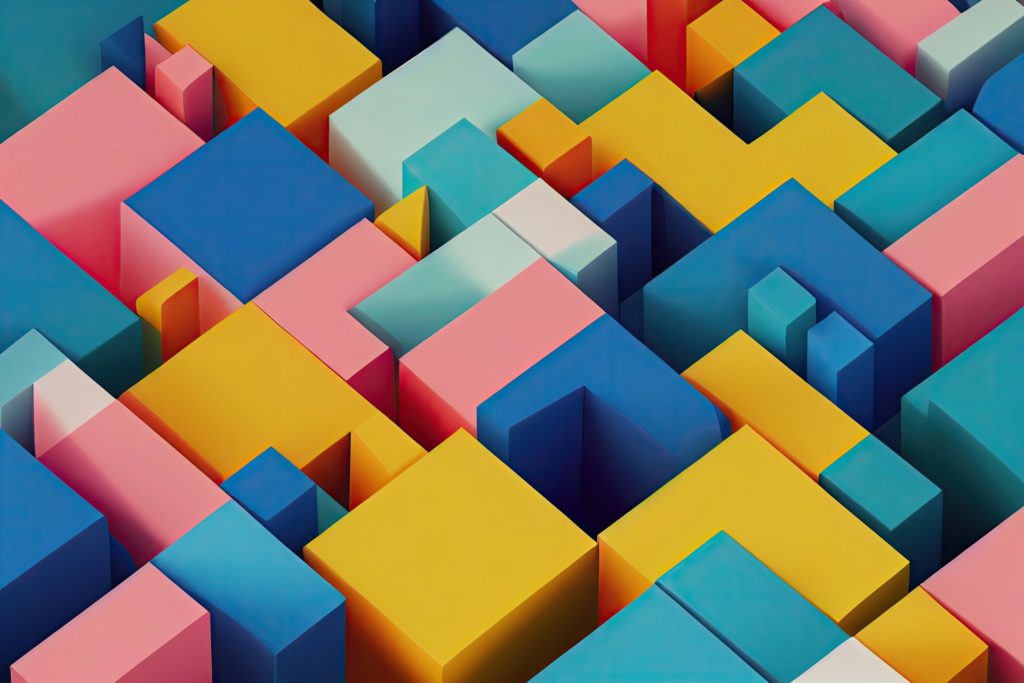Par Romain BENDAVID
Beaucoup de salariés aspirent actuellement à rééquilibrer la place du travail dans leur vie afin de la rendre plus compatible avec leurs priorités personnelles. Ce constat conduit à s’interroger sur la solidité de l’engagement envers leur employeur. Plusieurs faisceaux d’indices témoignent en effet d’un attachement moindre. L’indicateur de fierté d’appartenance à une entreprise a ainsi considérablement baissé en 20 ans, tandis que le nombre de démissions progresse depuis 2015à un rythme plus rapide que la croissance de la population active.
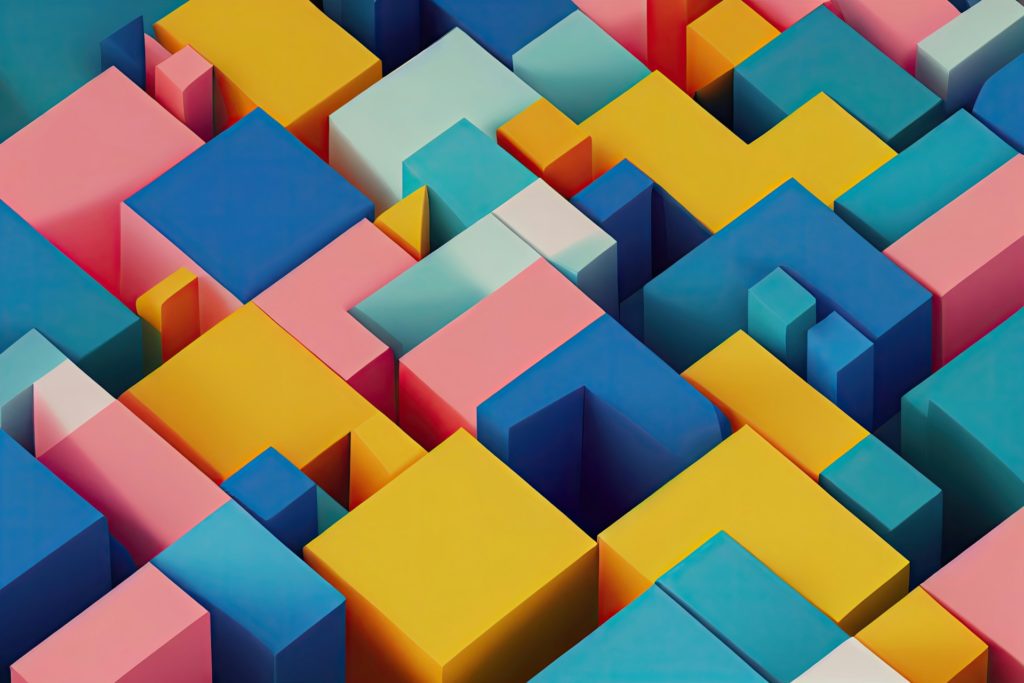
Les conséquences du nouveau rapport au travail se traduisent par une plus grande autonomie dans les horaires de travail et un désir plus affirmé de mobilité (principalement professionnelle et géographique). Et au-delà de ces nouveaux comportements, les trajectoires professionnelles plus disruptives, compliquent le retour à des standards qui ont longtemps prévalu.
La sphère professionnelle n’est toutefois pas la seule à subir une érosion de l’engagement. Ce phénomène représente une tendance lourde de notre époque. Dans un univers du tout numérique, proposant une infinité de choix aux consommateurs, la volatilité de ces derniers ne cesse de croître, d’où un engagement moindre vis-à-vis des marques. D’autres champs sociétaux connaissent une tendance similaire à l’instar des reculs de la pratique religieuse, du militantisme politique ou encore des mariages. Les algorithmes, qui proposent des contenus adaptés aux goûts et valeurs de chacun, tendent aujourd’hui à se substituer à ces formes d’engagement plus traditionnels.
Repenser l’engagement
Cette nouvelle donne oblige les entreprises à repenser la notion d’engagement au risque de se retrouver dans l’incapacité de fidéliser leurs meilleurs collaborateurs, avec le coût qui en résulte en matière de recrutement et de formation.
Pour redynamiser le lien à l’employeur, une première piste réside dans la (re)construction d’une relation de confiance pérenne. A l’image de la culture française de l’exercice du pouvoir, l’organisation managériale dans les entreprises est encore très verticale. Celle-ci se manifeste par une confiance insuffisante vis-à-vis des échelons inférieurs. Dans les enquêtes internes en entreprise, les collaborateurs soulignent en effet souvent la faible propension des supérieurs hiérarchiques à déléguer, à encourager la prise de décisions ainsi que la conviction partagée qu’en l’absence de surveillance le travail sera mal fait. Les salariés font également part d’une obsession pour le contrôle et les process (reporting dans le privé et normes dans le public). Il en résulte une difficulté à avancer selon un mécanisme d’itérations essai/erreur. En résumé, si la confiance n’exclut pas le contrôle, trop de contrôle finit par lui nuire.
In fine, dans un environnement professionnel complexe, où les fonctions sont de plus en plus anonymes, la confiance participe à réduire un sentiment d’insécurité. Elle permet de se projeter dans la durée et de consolider le lien à l’entreprise. L’exemple du télétravail est à cet égard éclairant. Selon une enquête publiée par la CFE-CGC en 2023, un cadre sur cinq estime que leur employeur ne fait pas confiance aux salariés lorsqu’ils travaillent à distance.
Produire du collectif
Le concept d’entreprise élargie constitue un autre potentiel booster d’engagement. Dans une sorte de chassé-croisé, la place moins centrale au travail s’accompagne en parallèle d’un souhait que l’entreprise s’implique davantage sur des enjeux sociétaux. Ces derniers ont trait à l’environnement (sans tomber dans le piège du Green washing), l’égalité femme homme (qui a connu ses avancées récentes les plus significatives dans le monde du travail), l’inclusion de personnes handicapées ou socialement en difficulté ou encore, le raccourcissement des circuits de distribution. Les collaborateurs aspirent en outre à y apporter leur propre contribution, à être acteur des actions de leur entreprise dans ces domaines. Dans une société très individuelle et solitaire, l’entreprise est ainsi une des dernières structures à produire du collectif.
Plusieurs résultats d’enquêtes récentes illustrent ce constat. 82% des salariés d’une entreprise de plus de 500 personnes (qui ont davantage de moyens à consacrer à ces questions, contrairement aux TPE et PME) considèrent par exemple que l’entreprise joue un rôle important au sein de la société, tandis que 78% d’entre eux estiment que défendre ou promouvoir le rôle de leur entreprise est une responsabilité importante, en tant que salarié. Plus concrètement, alors que 71% des Français se disent inquiets du réchauffement climatique, 59% affirment dans le même temps que le recul des engagements des entreprises pour la diversité et l’inclusion seraient une « mauvaise chose ».
Un des atouts de ce levier d’engagement autour de l’entreprise élargie réside dans sa capacité à faire consensus entre dirigeants et salariés. Signe ce cet alignement de planètes, parmi des évolutions « plutôt souhaitables » de leur entreprise dans les années qui viennent « l’importance accrue des indicateurs extra-financiers dans la performance de l’entreprise » est la plus partagée par les dirigeants (82 % d’entre eux).
L’engagement corporate ne s’entretient donc plus seulement par une adhésion à des valeurs souvent théoriques et qui tendent à se confondre d’une structure à l’autre (ouverture d’esprit, sens du collectif, respect…). Il se façonne dorénavant aussi via une identification au comportement extérieur de son employeur.
Respiration et temps long
La troisième piste pour réinsuffler de l’engagement est plus informelle. Elle consiste à accorder plus de temps de respiration aux collaborateurs. La période Covid et ses longs moments de confinements ont permis de réinvestir le rapport au temps. La mise sur pause des interactions sociales a été propice à une introspection sur le sens de sa vie et, partant, de son travail. Si cette période est révolue, il en reste une volonté de ne pas retomber dans une « dictature de l’urgence ».
Cette ambition se manifeste de deux manières. D’une part, une résolution à optimiser son temps de travail au service d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. D’autre part, une aspiration à se projeter sur le temps long, à élargir le champ des possible, que ce soit en en matière d’orientation professionnelle ou de nouveau lieu de vie.
Accorder plus de temps de respiration peut par exemple consister à proposer des formations pas nécessairement liées à l’activité quotidienne mais, malgré tout, compatibles avec celle de l’entreprise. Dans ce prolongement, les considérations actuelles autour d’une baisse de la productivité semblent un peu réductrices. Il pourrait s’évérer judicieux de les replacer sur le temps long. Miser sur un engagement sur la durée, porté par un plus grand sentiment de sens au travail, pourrait en effet largement combler le déficit de productivité à court terme.
En conclusion, il semble que l’engagement des salariés a plus muté qu’il ne s’est véritablement délité. Et il existe différents leviers pour le renforcer : une restauration de la confiance à « tous les étages », la possibilité d’être acteur des initiatives de son employeur sur des enjeux sociétaux ou encore la prise en considération du nouveau rapport au temps.
Romain Bendavid est expert Associé à la Fondation Jean-Jaurès et a dirigé pendant 10 ans le Pôle “Work Experience” à l’Ifop